Navigation
© MediaMed - 829as.11.2 020109

Psychologue clinicien de formation, Jean-Claude Liaudet a toujours mené de front l’intervention dans les institutions et sur les groupes, et l’écoute des individus. Cette articulation, jugée par d’aucuns contre nature, entre la dimension psychosociologique et la psychanalyse, il la reconduit dans "
Nous avons souhaité interroger l’auteur sur cet essai brillant, dont le style privilégie la scansion du fragment plutôt que la continuité d’un argumentaire propice à faire thèse mais typique d’un « scientisme dont l’idéologie libérale est friande ».
Ce livre à la critique affûtée paraît au moment où la conjoncture socio-politique laisse poindre l’idée que la fin verbeusement annoncée des idéologies, de la lutte des classes, voire de l’Histoire tout court, bute sur un réel qui fait tout simplement obstacle au singulier « principe espérance » du néolibéralisme. Celui-ci se voulait incarner une sorte de thérapeutique du politique enfin coupé de ses échappées oniriques, de ses visées utopiques et de ses lendemains désenchantés : en résultait un débouché... direct sur la R-é-a-l-i-té , - signifiant dont le "référent" est incarné par l’Entreprise ou le Marché. Pas de l’oie du Marché. Soumission à la jouissance du Capital délocalisé, et à l’irraison pure qui soutient son discours. L’âge de maturité du politique, serait celui où la quête du Bien commun, toujours adossé au pire, n’aurait plus lieu d’être. Il y aurait un babil totalitaire de l’aspiration au Bien commun et au changement.
Le néolibéralisme est donc apparu comme le système d’épuration et d’élimination des scories idéologiques du siècle finissant. Il fit consensus. Celui-ci semble pourtant moins compact. Car comme le montre JC Liaudet avec efficacité, la névrose collective libérale -à laquelle correspondrait la névrose narcissique de l’individu-, névrose collective dont les prémisses apparaissent au XVIIème siècle, paraît représenter une formation instable... limite, plus qu’une structure plastique, réellement organisatrice du lien collectif.

PSYTHERE - Dans votre introduction vous commencez par justifier le principe de votre approche, celle d’une psychanalyse du collectif .
Est-ce parce que les tentatives de nombre d’analystes éminents qui avaient franchi le rubicond d’une théorisation sur la Culture, voire de la Civilisation, se sont après coup révélées sinon « fantastiques » du moins mystifiantes par leur côté parfois simpliste (Reich, Marcuse..) ?
Ces dernières années divers essais de psychopathologie du champ socio-politique sont parus (de D. Sibony, M. Schneider, à J. P. Lebrun, et Ch. Melman). Comment interprétez vous ce regain d’intérêt pour la question politique ?
J-C. LIAUDET - J’ai voulu en effet, vis-à-vis d’une certaine doxa analytique selon laquelle il n’y aurait de psychanalyse que de l’individuel, rappeler comment Freud, de Psychologie des foules et analyse du moi à L’homme Moïse et la religion monothéiste, a travaillé la question de l’articulation de l’individuel et du collectif. Il lui paraissait impensable que chaque individu recommence le monde en naissant (voilà un fantasme libéral !), il fallait donc que l’expérience humaine se transmette de génération en génération. Mais comment ? Puisant dans l’arsenal scientifique de son époque, il s’interrogea sur une éventuelle transmission phylogénétique.
Aujourd’hui, on peut dire que le langage y suffit. Si on veut bien ne pas réduire celui-ci à un outil de communication, et sortir de la logique des théories informationnelles qui imprègnent le cognitivisme comme le comportementalisme, aujourd’hui si prisés en psychiatrie, on peut dire que parler c’est intégrer le système collectif d’idéaux et de lois inhérent au langage. Puisque c’est par le langage que le sujet advient, on pourrait risquer cette formule : le sujet individuel est un effet du collectif. Ce qui n’est pas sans effet dans la clinique : le symptôme présenté par un patient est indissociablement collectif et individuel. On le constate tous les jours, sans rien en faire. Et inversement : j’aime cette remarque de Castoriadis, un dictionnaire est mort, dit-il, s’il n’y a quelqu’un pour le parler. Autrement dit, c’est par le sujet individuel que s’énonce le collectif.
C’est dire que l’on peut tenter autre chose qu’une psychanalyse appliquée à la vie politique (forcément réductionniste), comme le fait Michel Schneider dans Big mother, ou encore Charles Melman dans L’homme sans gravité. Les travaux de Jean-Pierre Lebrun, mais aussi de Dany-Robert Dufour me paraissent, eux, constituer une tentative pour articuler histoire collective et histoire individuelle.
Si ces divers travaux apparaissent aujourd’hui, c’est que l’univers néolibéral met la psychanalyse en porte à faux : la question de sa survivance se pose. Si la place du psychanalyste en institution a toujours été problématique, la logique techniciste qui prévaut maintenant en psychiatrie la rend apparemment inutile. Certains psychanalystes comprennent qu’ils ne peuvent rester enfermés dans leur cabinet, et qu’ils ne peuvent non plus se situer dans la demande sociale de « psy » qui se développe aujourd’hui : la vie psychique y est représentée sur le modèle du corps morcelé de la médecine, elle requiert un technicien susceptible d’éradiquer un symptôme sans en chercher le sens. Une sorte de garagiste de l’âme. Il devient donc urgent de repenser la place sociale du psychanalyste - et la place du social dans la psychanalyse.
Pour ma part, je me suis appuyé sur la réflexion que mène Roger Zagdoun, notamment dans dipe le garçon, la prohibition de l’inceste et la fonction paternelle [1] et dans Hitler et Freud, un transfert paranoïaque [2]. Pour lui, le Totem et tabou décrit par Freud ne se résume pas à l’hypothèse historique du meurtre du chef de la horde, ainsi promu comme père. Zagdoun rend également compte de la mise en place du Tabou, c’est-à-dire d’une phobie collective à l’endroit d’un danger symbolique qui serait la mort-inceste, apparu avec le langage qui lui confère ce sens, dans un temps où le rôle procréateur du père aurait encore été méconnu. Cette première phobie s’organiserait autour de l’évitement du trou originel, lieu de passage de la mort à la vie (et de la vie à la mort dans l’inceste), également trou dans le langage, puisque le signifiant « mort » ne renvoie à aucun signifié. A cet évitement correspondrait un refoulement primaire, où l’on peut voir l’origine de l’inconscient. Phobie collective, donc, organisée par les premiers tabous : phobie, c’est-à-dire symptôme, c’est-à-dire « névrose pour tous » transmise dans le langage. Si la névrose collective est « bonne », c’est-à-dire si elle permet un compromis acceptable pour la pulsion, l’individu ne présente pas de souffrance ; si elle est « mauvaise », c’est à dire si elle ne facilite pas un refoulement efficace des désirs incestueux ou des souhaits de parricide, l’individu présente alors des symptômes. Les délires totalitaires (nazisme, stalinisme) en sont une illustration. Il serait intéressant de voir en quoi ils s’articulent au triomphe du libéralisme classique et à l’apparition de la seconde mondialisation [3], au début du XXème siècle.
 « Véritable Portrait de Monsieur Ubu » par Jarry soi-même... |
PSYTHERE - Est-ce d’ailleurs une théorisation de la Culture ou du politique ? Autrement dit, s’agit-il d’une interpellation du libéralisme comme pensée système politique, ou comme idéologie culturelle ?
J-C. LIAUDET - On peut en effet distinguer une dimension imaginaire, celle de la culture prise comme système d’idéaux présentés dans des images [4] (celles de la religion, de la politique, de la science) et une dimension réelle, celle de l’histoire, du politique. Mais l’une ne va pas sans l’autre. Le roi fondait son pouvoir historique, réel, sur sa désignation par le dieu imaginaire. De même la république se fonde sur la volonté collective. Dans Le complexe d’Ubu, je passe d’un niveau à l’autre. Mais je privilégie, je crois, le niveau de la culture. Le réel de notre histoire est présent sous forme de vignettes, d’illustrations. Quels sont les idéaux d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous fait jouir en régime libéral ? Voilà les questions qui m’intéressent.
PSYTHERE - Vous dites dans la foulée du Freud de « Psychologie des foules et analyse du moi » : « c’est parce que des individus partagent le même idéal qu’ils composent un groupe ou une société...tous partagent le même idéal du moi ». Ce partage ne tend-il pas à l’impossible, rendant compte de la forme inédite prise par le lien social, la diffraction repérable de l’ideal du moi collectif se manifestant au travers même du morcellement « communautariste » au sens large ?
Quel est dans cette hypothèse, le statut de ce « sujet collectif » ? Y a-t-il une seule névrose collective ?
J-C. LIAUDET - Je crois que le sujet, individuel ou collectif, ne correspond pas à notre désir d’unité. Le sujet est par nature divisé, on le sait bien, il est le champ de conflits, voilà même une façon de le définir. Tant qu’il y a du conflit, il y a de la vie ! De même, pour qu’il y ait du collectif au niveau réel, pour que des hommes et des femmes énoncent un « nous », il faut qu’il y ait plusieurs groupes sociaux différents et donc en conflit. Si l’uniformité s’installe, la société implose.
Que l’idéal du moi soit composite, fait de bric et de broc, rien d’étonnant. Il n’empêche que tout conflit trouve, à chaque moment et pour un temps, une résolution qui reflète un état du rapport des forces psychiques.
Quant au communautarisme, j’y verrais plutôt (comme pour les nationalismes) un effet de l’idéal individualiste, aujourd’hui néolibéral mais au travail depuis plusieurs siècles. Il conjugue à loisir les fantasmes d’autoprocréation et d’autosuffisance... Beaucoup « d’auto- » qui ne favorisent pas, en effet, le lien social...
PSYTHERE - Pour clore ce volet, le clivage entre Civilisation -comme formation collective coercitive surmoïque, et Culture -formation collective liée à l’idéal du moi, est-il toujours pensable dans les mêmes termes qu’à l’époque de Freud ?
N’y a t-il pas au niveau du collectif, un laminage de ces instances -surmoi et idéal du moi-(dont témoigne l’efflorescence des pathologies du « narcissisme »), laminage estompant l’écart entre surmoi et idéal du moi, et finalement entre Civilisation et Culture...
Ne sommes nous pas entrés cependant dans l’âge de la Civilisation triomphante où s’annonce la fin de la Culture ? N’est-ce pas cela aussi la névrose libérale ?
J-C. LIAUDET - Oui, en un certain sens. Dans la névrose libérale, l’invitation nous est faite de ne renoncer à rien. Invitation illusoire, même pour les héros libéraux, maîtres des phynances censés se situer au-dessus des lois ; pour les autres innombrables, c’est dans le cocooning et le virtuel qu’ils sont incités au bonheur sans entrave. Moins de surmoi en tant que censure, en tant « qu’héritier du complexe d’Oedipe », donc. Mais aussi plus de surmoi, en tant que force « obscène et féroce », selon le mot de Lacan, puisant dans le sadisme du ça, beaucoup plus de culpabilité sans nom et sans visage, parce que désarrimée des idéaux, exigeant un sacrifice que plus rien n’encadre.
A propos de l’idéal du moi, j’aime bien ce mot de Dany-Robert Dufour [5] : le Grand Sujet, dit-il, n’est plus du côté du Père, mais du Marché. Marché que j’associe à une mère phallique et infiniment généreuse. Mais peut-on encore invoquer quelqu’idéal dès lors qu’il n’y a plus de tiers... En ce sens, on devrait parler de psychose libérale, plutôt que de névrose. Une psychose à froid, caractérisée par une perte de tout repère, où le besoin remplace le désir.
PSYTHERE - D.Laporte et son « Histoire de la Merde » (Bourgeois, 1993), rapporte entre autres, que c’est au temps de ce que vous appelez la « première décompensation collective » (1572) que paraît un édit de François premier réglementant les ordures (1539) Ainsi pour lui, « l’économie n’a jamais été plus qu’alors lieu de merde, lieu de corruption démarqué comme tel de toute morale : la Renaissance marque par exemple, les économistes nous le disent, l’abandon de la règle médiévale de modération du bien, et le développement de théories mercantilistes, toutes définies --... -- d’un but unique à atteindre : enrichir la Nation. »
Tout votre livre scande d’une certaine façon cette idée.
Ubu, sa Merdre, sa pompe à phynances, serait-il le vrai patron du ME(R)D(R)EF...durement épinglé par la société in-civile ces derniers temps ?
J-C. LIAUDET - On pourrait en effet imaginer les adeptes du bien-nommé ME(R)D(R)EF défiler en cortège derrière leur saint patron, un immense Ubu de carnaval... Ce serait compter sans les formations réactionnelles : l’obsession de la propreté (le costume gris, les mots feutrés, les chiffres sans odeur, la monnaie virtuelle enfin débarrassée de toute liquidité...) masque le goût pour la saleté ; et la manie gestionnaire et organisatrice vient donner à la férocité comme à l’avidité leurs lettres de rationalité froide. Le personnage d’Alfred Jarry me paraît donc fonctionner comme un analyseur : il arbore sur son ventre un labyrinthe intestinal, zone érogène autour de laquelle son monde s’organise. Comme toute figure baroque, il expose au grand jour ce qui devait rester caché.
Alors que je réfléchissais sur les liens entre libéralisme et analité, j’ai donc tout naturellement fait d’Ubu le saint patron de mon livre ! En lui, on peut retrouver les grands traits de l’âge sadique-anal qui me paraissent constitutifs de la névrose collective libérale : mégalomanie et volonté de toute puissance ; refus de toute loi vécue comme contrainte, comme empêchement de « liberté » ; ignorance d’autrui ; sadisme ; goût pour la collection et le maniement des matières ; découverte de la propriété comme partie du corps (l’étron) à échanger avec la mère (ou à l’en priver dans la constipation, avec l’autoérotisme de la rétention en prime) avec, en fond de tableau, l’équivalence merdre/monnaie... tout un programme, qui me paraît être celui du libéralisme.
PSYTHERE - Vous dotez donc Ubu d’un complexe et vous ployez le libéralisme sous le joug de la névrose. Il semble plutôt qu’en vous lisant, l’on doive osciller entre névrose, psychose et perversion. Pourquoi effectivement névrose au final ?
J-C. LIAUDET - En termes de structure, je vous le disais il y a un instant, on pourrait en effet parler de psychose. A cette différence près que, du XVIIème au XXème siècle, le libéralisme s’est construit dans le rejet (et donc la reconnaissance en négatif) du père social réel, historique (le roi, l’état), comme du père imaginaire, culturel (dieu). A la fin du XXème siècle, avec l’épanouissement du libéralisme sous sa forme qualifiée de « néo », c’est peut-être bien à l’effondrement du système symbolique paternel, à la forclusion du père chrétien qu’on assiste - laquelle plonge le sujet individuel dans un état de perplexité, de dépersonnalisation, il se trouve pris, on pourrait dire coffré, dans l’armature d’un discours pervers qui évite le plus souvent d’avoir recours aux efflorescences du délire.
La perversion me semble donc jouer le rôle d’un mécanisme de défense qui permet de faire l’économie du délire. Dans ce bétonnage, le scientisme (notamment le scientisme économique) tient lieu du fer qui permet à la construction de tenir.
J’ai conservé le terme de névrose dans la mesure où ce que l’on peut souhaiter c’est une bonne névrose collective, c’est-à-dire une formation de compromis qui permet de refouler l’inceste et le parricide, de façon telle que les symptômes qu’elle produit immanquablement soient néanmoins vivables.
PSYTHERE - Sur le même motif, je dirai que dans le tryptique capitalisme, postmodernisme, libéralisme, vous semblez dénoncer la logique sadique-anale du capitalisme, et penser que le libéralisme pourrait s’en délivrer. Quant au postmodernisme, il fait figure de symptôme sans valeur structurelle.
J-C. LIAUDET - Il me semble que, dans l’histoire, le destin du libéralisme n’a pas été immédiatement noué au capitalisme. L’Areopagitica de John Milton (1644), le John Locke de La lettre sur la tolérance (1686) revendiquent pour l’individu une liberté vis-à-vis de l’Etat. C’est pourquoi il me semblerait intéressant de repérer quand et comment se nouent les thèmes de la liberté et de la propriété - chez Locke, déjà, quand il décrit un droit « naturel » à la propriété, quand il cherche à « libérer » l’économique du politique en arguant de son antériorité.
Je me demande donc si l’idée d’un post-libéralisme dégagé de l’analité capitaliste ne représenterait pas une voie de progrès. C’est une question, une simple piste où, peut-être, ne pas désespérer. Quant au post-modernisme, en effet, je le considère comme un effet de la mise en place du néolibéralisme, version « hard » de la névrose libérale.
PSYTHERE - Vous définissez, deux ou trois âges de la névrose collective pour lesquels vous mettez en exergue les moments fondamentaux d’émergence, la scène primitive en quelque sorte, et la nouvelle recomposition du lien social témoignant de l’agencement de la nouvelle névrose collective.
Nous aurions ainsi fini à notre époque, de vivre dans le deuxième âge de la névrose collective, celle de l’entre-deux névroses, dont la temporalité s’inscrit entre les prémisses de la Révolution française et la fin des années 80 (chute du mur de Berlin). Cet entre-deux névroses, a été la période de coexistence de la « névrose libérale » que vous référez de manière à vrai dire assez convaincante à la position sadique-anale, et de la névrose collective chrétienne que vous référez malgré tout au paradigme oedipien, mais il apparaît surtout comme un long processus de mutation, qui depuis la fin des années 80, laisse la « névrose » libérale organiser seule la nouvelle donne anthropologique contemporaine (troisième âge). En occident du moins.
Vous parlez parfois de cette mutation en terme de « régression ». Qu’en est-il plus précisément ?
B. Grunberger et P. Dessuant, dans « Narcissisme, christianisme, antisémitisme » ont stigmatisé de manière fort critique la régression narcissique et le conflit prégénital non résolu du christianisme. La fixation prégénitale qui caractériserait le libéralisme, pourraît-elle être un reste de la "névrose chrétienne" ?
J-C. LIAUDET - Le terme de régression peut porter à confusion s’il réfère à un schéma d’évolution. J’ai employé ce terme, peut-être un peu rapidement, pour marquer le fait que dans la logique anale, la question de la différence des sexes (et par là même, à mon sens, la question d’un autre à la fois différent et semblable - et donc la possibilité d’un lien social fondé sur l’amour) ne se pose pas. Mais je n’avais pas en tête une idée de progrès telle que la succession des sociétés (caractérisées par des névroses collectives) refléterait, analogiquement, un soi-disant progrès individuel marqué par une hiérarchie de « stades ».
Le fait que la névrose collective libérale soit née sur le terreau de la névrose collective chrétienne ne peut que l’avoir marquée, certainement. Le père chrétien imaginaire souffrait d’un défaut de castration : Jahvé n’a pas besoin d’une femme pour concevoir Adam, il est l’une et l’autre à la fois. Il se trouve pris dans une formule tautologique qui me semble être le comble de l’inceste : « je suis celui qui est ». Ce plus-que-tout paternel va faciliter une perte des idéaux religieux au moment des guerres de religion, au XVIème siècle. Alors, le père culturel imaginaire (dieu) commence à se trouver dissocié, en même temps que du pape, du père social réel : apparaît le thème du « roi abusif » gouvernant cyniquement selon la raison d’état (en 1589 chez Giovanni Botero).
Cette défaillance de l’idéal paternel, sur la terre comme au ciel, va laisser une place pour une autre organisation psychique. Elle dynamise un « non » qui reste anal, du fait de ne pouvoir s’énoncer dans un champs nettement déployé comme oedipien (Jahvé n’est pas accouplé, il est père et mère à la fois - de même, le pape est symboliquement homme et femme[6] ). On pourrait donc supposer que le raté oedipien de la névrose chrétienne a prédisposé au passage à une logique anale : à vérifier !
Une autre scène primitive, pour reprendre votre mot (je préférerais dire scène originaire), ayant une importance aussi décisive à mes yeux que celle des guerres de religion est ce que l’on a coutume de désigner du terme religieux de Shoah (ce qui me paraît un mauvais choix, parce que inscrit dans la seule logique juive). Il paraît qu’il n’y aurait rien à en dire : en effet, l’inceste passé en acte prive de parole... mais dire cela c’est quand même parler, et il le faut. Ne pas vouloir mettre de mots sur la Shoah, c’est rester dans la complicité de l’acte, en définitive y participer.
Sur cette interprétation de la Shoah comme retour du désir incestueux refoulé, rendu possible par la mise en défaillance de la névrose chrétienne, Roger Zagdoun nous apporte des clés[7]. Après ce passage à l’acte délirant, rien ne plus être comme avant : extinction de la névrose chrétienne, épanouissement de la folie néolibérale... On bascule de la forclusion de la mère à la forclusion du père...
En conclusion, si l’on peut parler de régression, c’est que, en régime libéral, l’unaire nous guette [8].La trinité chrétienne mettait en place un système symbolique où un père plus-que-tout nous épargnait, malgré tout, la confrontation à une mère au sein phallique, en qui tout se résout, sinon se dissout : à savoir le Marché...
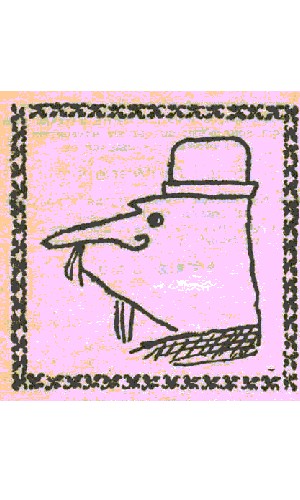 « Autre Portrait de Monsieur Ubu », en version réactionnelle |
PSYTHERE - Faites vous, vous aussi, partie des "nouveaux réactionnaires" estampillés par D. Lindenberg ... ?
J-C. LIAUDET - Pourquoi pas ? Je refuse de m’enfermer dans une alternative libéralisme/socialisme, c’est pourquoi je tente le terme de post-libéralisme. Je suis d’accord avec Jean-Claude Michéa quand il pose qu’ils ont trop de paradigmes en commun.
PSYTHERE - La figure stylistique de l’oxymore semble particulièrement mise au travail dans le discours libéral. Le discours libéral est-il animé par une logique primaire (au sens des processus primaires), hostile, comme vous le montrez et comme on l’entend ces jours ci à la pensée, et au désir, à la complexité de leur structure ?
J-C. LIAUDET - L’oxymore se caractérise par le rapprochement de deux mots qui semblent se contredire. L’obscure clarté qui tombe des étoiles reste néanmoins proche, me semble-t-il, du jeu métaphorique, nécessaire pour désigner l’absente de tout bouquet. Il n’en est plus de même lorsqu’on parle, par exemple, de tulipe en matière plastique naturelle. On est alors plus proche du mécanisme de dénégation, typiquement pervers, où l’on va poser que ce qui n’est pas est ; et tout aussi bien que ce qui est n’est pas. On est alors, en effet, proche des processus primaires régissant le système inconscient. Nos « exclus » de toutes sortes en sont là : perdu le langage, ils connaissent le court circuit de la pulsion à l’acte - cela s’observe à l’école, notamment.
Dans la logique perverse, le discours ne sert pas à penser, à découvrir une vérité à venir, mais à assujettir l’autre à une vérité déjà établie - en fait celle du désir de son énonciateur ! À ce jeu, tous les coups sont permis pourvu qu’ils soient efficaces ! Dès que l’on a repéré cette stratégie, on peut prendre plaisir au décodage : d’un plaidoyer politique comme d’une pub à la télé.
Ce qui est exclu de ce jeu, c’est la pensée. Qui ne peut se déployer qu’à partir de la castration primaire, c’est-à-dire de l’apparition de la sexuation et dans le même temps de la mort ; d’une génération antérieure transmettant un savoir ; d’un autre de l’autre sexe, semblable et différent, avec qui le dialogue peut s’instaurer, dans les registres du savoir comme de l’amour... nous voguons alors à une distance infinie du pragmatisme nécessaire au maniement des valeurs, nous sortons du registre de la rentabilité. Pour reprendre un mot de Hobbes, on pourrait dire que pour le libéral, penser c’est compter.
Au reste, l’homme libéral ne connaît pas la mort, pas plus que l’enfant de l’âge sadique-anal. Le scientisme l’y aide : bientôt, vous le savez, nous serons immortels... La biologie et la médecine y travaillent...
PSYTHERE - Que pensez vous justement de la mobilisation des intellectuels, des chercheurs, des artistes, et des professionnels qui ont un rapport distant à la logique du libéralisme ?
J-C. LIAUDET - J’ai indiqué dans Le complexe d’Ubu la haine libérale de la pensée : celle-ci représente en effet un danger, elle risque de défaire les montages pervers de la rhétorique libérale, et plus globalement sa logique de la dénégation. La question de la vérité est à forclore, la vérité empêche l’équivalence généralisée de toutes les valeurs, de tous les idéaux. La vérité est à bannir, car elle permet de poser ce qui est juste et bon, et peut devenir le fondement de la loi. Elle s’oppose à la liberté libérale, qui est refus de toute limite.
PSYTHERE - Le statut symbolique et imaginaire des pères dans notre horizon contemporain néolibéral parait grevé du signe moins : sommes nous passés du père plus-que-tout au père moins-que-rien ?
Est-ce l’a-mère-version...du discours mercantiliste ? Qu’est-ce qu’être un père au temps du "jouir sans entraves" de la morale sadienne-libérale ?
J-C. LIAUDET - Le déclin du système symbolique paternel est une longue histoire qui commence avec la mort du fils de dieu sur la croix, un fils abandonné par le père - ainsi, pour Lacan, l’athéisme est-il posé par le christianisme.
Les premiers auteurs libéraux, eux, s’élèvent contre l’intolérance paternelle. Leur mise au travail de la culture trouve dans l’histoire son écho avec la mise à mort du père social, et la création d’une République en laquelle nous sommes libres et égaux (les deux conditions nécessaires pour fonder l’idéologie libérale du contrat), mais également frères[9], unis dans le meurtre d’un père social qui n’en fut pas pour autant idéalisé, et sans que la République monte au ciel pour le remplacer : on sait que la tentative d’établissement d’une religion républicaine laïque fut un échec. Dès lors, les frères deviennent des nourrissons abouchés au sein du Marché.
Du père, que reste-t-il ? Il n’est plus celui qui énonce ce qui est juste et bien, ni celui qui prend en charge le bien-être de son enfant, le social jouant désormais un rôle plus décisif que le sien. Il lui reste, dit Philippe Julien[10], à transmettre la loi du désir, en fermant à son enfant la porte de la chambre des parents, en lui interdisant de connaître l’homme et la femme que sont son père et sa mère... Le programme libéral vise à faire sauter ce dernier verrou : la famille conjugale hétérosexuelle tombe en désuétude, et les perspectives ouvertes par le clonage permettent de rêver à un monde enfin débarrassé du sexe...
PSYTHERE - Passons des enjeux de la « Cacanie » libérale, à ceux de la "Translacanie". Il semble que la pluralisation des noms-du-père, joue comme opérateur spectral, révélant finalement des positions "politiques" très contrastées entre les groupes lacaniens notamment sur des enjeux sociétaux d’importance, où des clivages abrupts apparaissent au grand jour opposant libertariens et vieux réacs, postmodernistes et modernistes...
Tout cela est-il à mettre au compte des effets du transfert à la personne et au texte de Lacan ?
J-C. LIAUDET - Sans doute, et plus encore à l’acte posé par Lacan le 5 janvier 1980, quand il dissout, seul comme toujours, L’Ecole Freudienne de Paris - refusant de la voir se constituer elle aussi (comme la SPP, l’IPA) en église. La communauté lacanienne devenue son symptôme (l’inanalysable de Lacan évoqué par Loewenstein ?), livrer les adeptes à l’éparpillement en les privant d’un transfert institutionnalisé dans l’EFP fut peut-être bien un acte analytique...
NOTES :
BIBLIOGRAPHIE
Entretien réalisé en Mars 2004 par Frank BELLAICHE.
© 2000 - 2026 Psythère - Tous droits réservés